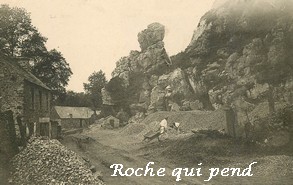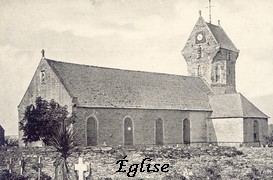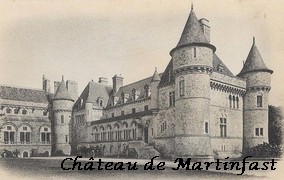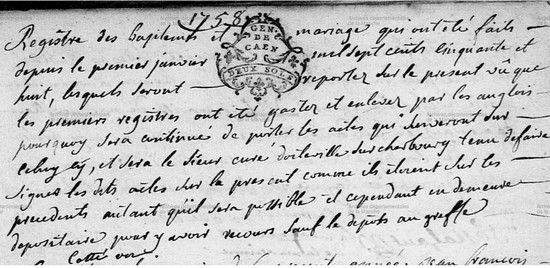Après son
envoi Jean René m'a envoyé ce qui suit :
j'ai trouvé que les anglais on débarqué à l'ouest de Cherbourg une
troupe de 15000 soldats et 600 chevaux pour détruire le port de
Cherbourg.
Ce raid fait partie d'une série pour soulager le front sur l'Allemagne
et obliger la France à garnir ses ports (guerre de 7 ans). Ils sont
restés du 8/8/1758 14/8/1758.
Le port de Cherbourg et tout les navires et bateaux y compris de pêche
ont été brulés. Les canons embarqués et montrés en procession à Londre.
La troupe a fait des ravages et les anglais ont taxés les bourgeois de
Cherbourg ainsi que la manufacture de glace de Tourlaville (est de
Cherbourg).
https://books.google.fr/books?id=b4ABAAAAQAAJ&pg=PA135#v=onepage&q&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raid_sur_Cherbourg
Contexte
Accumulant les
défaites en Europe continentale, le gouvernement britannique décide, à
partir de 1757, de tirer parti de sa supériorité navale pour lancer une
série de descentes sur les côtes françaises, en guise de diversion -
obligeant la France à retirer une partie de ses forces d'Allemagne (pour
protéger ses côtes), là où les alliés de la Grande-Bretagne, la Prusse,
Hanovre et le Brunswick reculaient. À l'automne 1757, une expédition
britannique sur Rochefort parvient à capturer l'île d'Aix, mais échoue
devant la ville et doit battre en retraite. En 1758, le duc de Brunswick
demande à ses alliés britanniques de mettre leur politique en œuvre pour
soulager ses troupes qui enchaînaient les défaites. Une importante
flotte est armée au sud de l'Angleterre, sous la supervision de l'amiral
Anson, le First Lord of the Admiralty. En juin 1758, les Britanniques
lancent un raid sur Saint-Malo. Face au succès rencontré lors de cette
expédition, un nouveau raid est envisagé et il est prévu que le Prince
Edward, le frère cadet de Prince de Galles ferait partie de
l'expédition.
Le raid
Les forces terrestres
britanniques sont placées sous les commandement du Lieutenant General
Thomas Bligh, alors que le commandement de la flotte est confié au
commodore Richard Howe1. La flotte britannique croise le long des côtes
de Normandie, menaçant un certain nombre de ports, avant d'arriver en
vue de Cherbourg le 7 août. Les conditions météorologiques étant
favorables, les Britanniques parviennent à débarquer leurs troupes. Une
fois à terre, ils balayent la petite garnison qui était chargée de
défendre la ville, lancent un assaut et capturent Cherbourg. Ils
entreprennent alors de détruire les fortifications et le port. Le 16
août, les Britanniques quittent Cherbourg et ré-embarquent après être
restés une semaine sur place
Conséquences
La nouvelle du succès
de cette expédition remonte le moral de la population en
Grande-Bretagne, toujours marquée par la perte de Minorque deux ans plus
tôt. Les journaux remarquent qu'il s'agit du premier débarquement — de
grande ampleur — à être couronné de succès depuis la guerre de Cent
Ans3. Cette politique de descentes navales était défendue par William
Pitt et ce succès l'encourage à lancer de nouvelles attaques sur les
côtes françaises. En septembre 1758, Bligh essaye de capturer
Saint-Malo, mais le gros temps l'empêche de débarquer l'intégralité de
ses forces, et ses hommes doivent rapidement se replier face à des
Français supérieurs en nombre. Bligh est alors contraint d'ordonner à
ses hommes de ré-embarquer, ce que les Britanniques parviennent à faire
au prix de lourdes pertes à la bataille de Saint-Cast. Cette défaite
marque la fin de la politique de raids et de « descentes navales », les
Britanniques préférant désormais engager davantage de forces en
Allemagne plutôt que de risquer un nouvel échec
Malgré ce dernier revers, ces raids ont
atteint leurs objectifs dans la mesure où ils atteignent le moral de la
population française, et montrent que le territoire de la France
métropolitaine était lui aussi sous la menace des attaques britanniques.
En réponse, la France planifie une invasion de la Grande-Bretagne,
destinée à mettre un terme au conflit, mais ces plans doivent être
abandonnés après les défaites de Lagos et de la baie de Quiberon.
La guerre de Sept Ans (1756-1763) est un conflit
majeur, le premier à pouvoir être qualifié de « guerre mondiale »2,3.
Elle mêle de façon conséquente les grandes puissances de l'époque,
regroupées dans deux ensembles d'alliances antagonistes, et se déroule
simultanément sur plusieurs continents et théâtres d'opérations,
notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Inde.
Elle oppose principalement le royaume de France,
l'archiduché d'Autriche, leurs empires coloniaux et leurs alliés, au
royaume de Grande-Bretagne, au royaume de Prusse, leurs empires
coloniaux et leurs alliés. Cependant, par le jeu des alliances et des
opportunismes, de nombreux pays européens et leurs colonies participent
à cette guerre, notamment l'Empire russe aux côtés de l'Autriche ainsi
que le royaume d'Espagne aux côtés de la France.
Le conflit s'est traduit par un rééquilibrage important
des puissances européennes4. En Amérique du Nord et en Inde, l'Empire
britannique sort vainqueur. Il fait presque entièrement disparaître le
premier espace colonial français. En Europe, c'est la Prusse qui
s'affirme au sein de l'espace germanique par les victoires de Rossbach
sur les Français et de Leuthen sur les Autrichiens (1757) : elle y
conteste désormais la prééminence de l’Autriche.
Le début de la guerre est généralement daté du 29 août
1756, jour de l'attaque de la Saxe par Frédéric II de Prusse, qui fait
ainsi le choix de devancer l’agression programmée par l’Autriche pour
reprendre possession de la Silésie. Cependant, l’affrontement avait
débuté plus tôt dans les colonies d’Amérique du Nord.
Britanniques en Amérique du Nord.
La guerre de Sept Ans débute lorsqu'une force formée de
Français et de Premiers Peuples expulsa des colons britanniques de la
vallée de l'Ohio, en 1754. Cet affrontement local se transforma vite en
guerre mondiale. À partir de 1755, la Grande-Bretagne et la France
envoyèrent des milliers de soldats professionnels en Amérique du Nord.
Un an plus tard, les hostilités s'étendaient jusqu'en
Europe et les deux nations se déclaraient officiellement la guerre. En
1759, elle faisait rage en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du
Nord et dans les Caraïbes, et Québec fut assiégée par une flotte et une
armée britannique.
Le conflit s'est éteint quand la France et la
Grande-Bretagne signèrent le traité de Paris, en 1763. Il résultait de
cette guerre une victoire écrasante de la Grande-Bretagne qui faisait de
ce pays la principale puissance coloniale du monde.
La rivalité entre Français et Britanniques en Amérique
du Nord
La France et la Grande-Bretagne transportèrent leur
rivalité jusqu'en Amérique du Nord.
Au moment même où les Français fondaient Québec et
combattaient pour survivre aux guerres post-contact, les Britanniques
établissaient de puissantes colonies dans le Sud. Coincés entre deux
empires, les territoires compris entre Québec et la baie de Fundy se
transformèrent rapidement en théâtres de guerre. Les Français et les
Britanniques luttèrent pour obtenir le contrôle des ports et des lieux
de pêche. Les établissements portuaires devinrent des centres pour les
activités navales, marchandes, de pêche, administratives et
commerciales.
La guerre de Sept Ans a été le premier conflit
d'envergure mondiale. Les combats ont commencé en Amérique du Nord et se
sont répandus à travers le monde. |