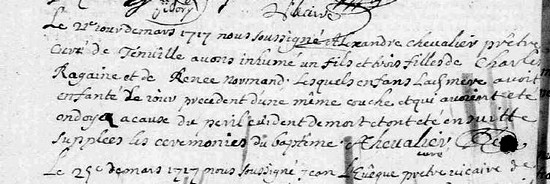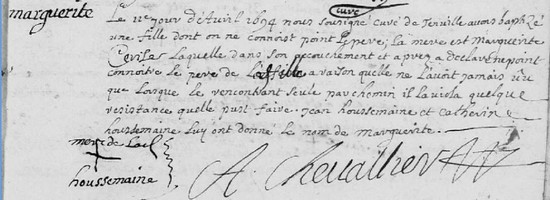verrerie
réserve des surprises. Plus de 40 ateliers de production identifiés, du
XIVe au XXe siècle
La mémoire locale a conservé le souvenir des verreries
de Tanville, de Saint-Évroult et de Tourouvre : celles-ci ont fonctionné
jusqu’à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle.La verrerie du Gast :
Usine de flaconnage, établissement attesté en 1532, produisant en 1801
des gobelets, carafes, verres à vin ; huiliers et pièces de chimie en
verre blanc, bleu ou vert, vendus à Paris, Rennes, Caen et les
départements voisins. Mise en place d’une taillerie et d’une machine à
vapeur par M. BOISSIERE vers 1871.Cessation d’activité vers 1883. Deux
fourneaux attestés en 1789 ; consommaient en 1801 mines de plomb rouge,
salpêtre, soudes d’alicante, sable, azur, verres cassés et bois de la
forêt d’Ecouves. Fabrication du verre au charbon de terre en 1865.Fours
chauffés au gaz de bois en 1867. |
 |
 |