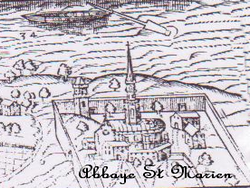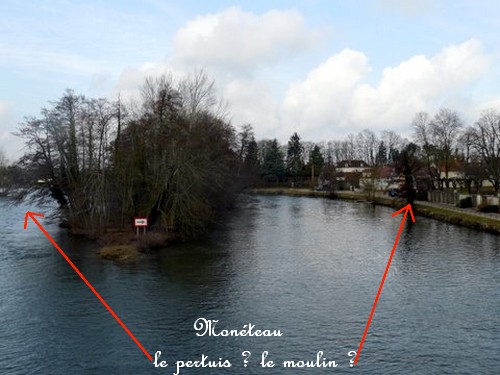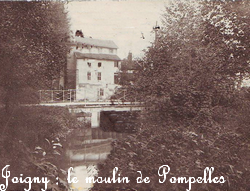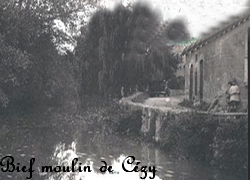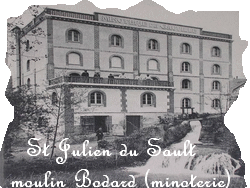|
Ce
moulin possédait un bateau qui permettait de se rendre à Régennes et à
Auxerre. |
|
Vient ensuite le
village de
Monéteau
qui, au XIIIè siècle, possédait moulins et
pertuis mais à quel endroit ? Il est dit qu'il était situé en face du
"Petit Monéteau", où était-ce ? et ce Petit Monéteau existe-t-il toujours ?
Voila une réponse qui arrive fort à propos : Avant la construction du pont
(1853), plusieurs gués séparaient les différentes parties de la commune
actuelle de Monéteau, à savoir le Grand Monéteau (rive gauche) et le Petit
Monéteau (rive droite) qui était annexé au marquisat de Seignelay.
Cité
en 853, "Monasteriolum"L'Yonne sépare le village en deux parties, Champigny
ou le Grand-Monéteau (rive gauche) et le Petit-Monéteau (rive droite).
Longtemps, de simples gués permirent la communication entre les deux
agglomérations.
Le premier
pont suspendu (à péage)
qui fut construit en 1853 s'écroula un jour. Le pont suspendu
actuel date de 1913.
Les fiefs de la rive droite furent achetés par Colbert en 1664 et réunis à
sa seigneurie de Seignelay.
L'ile au
milieu du lit de la rivière. Le moulin devait donc se situer à droite, c'est
à sa gauche que se trouvait le perré.
C'était
probablement la base sur laquelle venait s'appuyer le pertuis. |
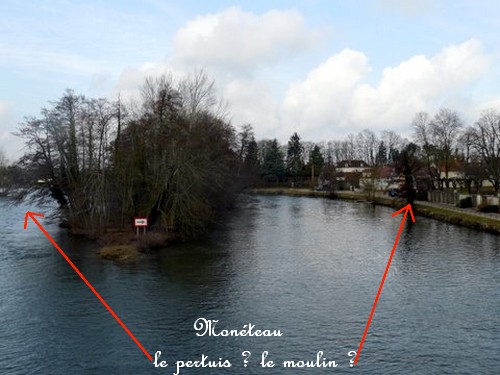 |
|
La partie droite
où devait se trouver le moulin a certainement subi bien des transformations
puisque c'est
|
|
maintenant le chenal de
navigation.
Nous voici
arrivés à Bassou
où les moines étaient sans cesse en procès pour
leurs droits sur les moulins et pertuis.
Le moulin
appartenait à l'abbaye Saint Marien au XIIè siècle. Les moines avaient
établis quand ? un droit de péage pour l'usage de leur pertuis et du
indart servant à la remonte des bateaux. Ce droit existait déjà en 1317.
Je n'ai retenu que deux documents concernant ces procès que nous verrons,
aussi au chapitre des redevances mais je trouve que
ce n'est pas digne de bons chrétiens. (Ça n'engage que mes convictions).
Et
s'il n'y avait eu que les moines !!! Au moins, eux, percevaient
leurs droit pour l'usage de leurs pertuis par les
voituriers ou flotteurs, ce qui, durant le passage empêchait les
moulins de tourner.
Les meuniers ou leur représentant,
quant à eux, abusaient de
la situation en obligeant les voituriers à leur donner : vin, marchandises
et espèces sonnantes et trébuchantes d'un montant assez élevé et en cas de refus de leur part
les pertuis n'étaient pas ouverts. Cela entraînât un nouveau procès que
cette fois-ci les marchands et voituriers gagnèrent.
Le prévôt
des marchands les condamna.
L'arrêt fut
affiché sur le port et lu au prône de l'église de Bassou.
Cela nous amène tout
doucement sur Joigny car je n'ai trouvé trace de moulin, entre ces
deux villes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient été
inexistants mais peut-être pas sujets à redevances ???? Je tiens tout de
même à citer une commune qui sans être sur l'Yonne mais sur un de ses
affluents l'Armançon, je veux parler de Brienon sur Armançon. Cela concerne
le pertuis établi sur cette paroisse.
|
 |
 |
|
C'est le métier qui a interpellé la
personne qui m'a adressé cela. En 1842 un certain Edme Pierre Nicolas CHAT
en était l'éclusier mais aussi déboucheur de pertuis. Fils de Pierre laurent
CHAT lui-même éclusier. Le fils d'Edme Pierre Nicolas CHAT, Nicolas né en
1823 Brienon et décédé en 1901, même commune, était aussi déboucheur de
pertuis, (1857) éclusier du pertuis (1877), pêcheur (1886) et enfin
marchand de sable (1896/1901). Son fils Edme Pierre CHAT né en 1817 à Cheny
était lui aussi déboucheur de pertuis et ainsi de suite. Qu'ils soient
voituriers, mariniers éclusiers déboucheurs de pertuis comme ci-dessus,
pêcheurs aussi ils l'étaient tous de père en fils et bien souvent épousaient
des filles dont les parents exerçaient souvent le même métier. |
|
Joigny,
les comtes de Joigny étaient naturellement propriétaires de la rivière sur
toute l'étendue de leur fief. Je n'ai pas trouvé de redevances concernant le
ou les moulins établis
sur cette portion de rivière.
Uniquement des droits sur la pêche et des droits de péage, mais à quoi
correspondaient-ils ???
|
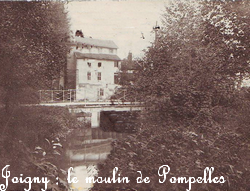 |
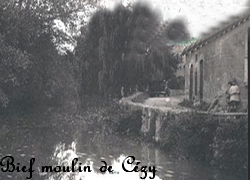 |
 |
|
Je ne
sais si c'est au pertuis du moulin de Cezy
mais le seigneur de Cezy percevait un droit de péage sur les bateaux
montants et avalants. Prélevé sur diverses marchandises. Le
droit de "Grande Coutume".En 1765 la rivière s'est trouvée partagée en deux
et s'est ouvert un nouveau lit dans le canal entre l'île et la rive
gauche,et les mariniers, pour éviter le coude de la rivière à Cezy, ont
essayé de passer par ce chenal mais pour les trains de bois c'était trop
difficile. Le temps faisant bien ou mal les choses, emporta un jour,
certainement au cours d'une crue, cette île. C'est ainsi que je ne l'ai pas
retrouvée mais les voituriers disaient à cette époque que Cézy passé, ils
étaient à Paris tellement cette commune était difficile à traverser.
|
 |
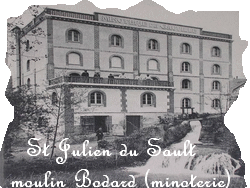 |
 |
 |
|
Si les difficultés de navigation était terminées ils n'en n'avaient
pas encore fini avec la traversée des paroisses et le franchissement du
pertuis des moulins.
St julien du Sault. J'ai trouvé
deux moulins sur cette paroisse : le moulin de la ville et le
moulin Bodard sur le frontispice duquel j'ai pu lire : minoterie.
Avant d'arriver à
Sens dernière grande ville avant Montereau. Il y eut des moulins à Villeneuve le
Roy, maintenant Villeneuve sur Yonne. Ces moulins se trouvaient
|
 |
 |
|
sur un ruisseau situé entre le
chemin de Dixmont et de Taloant. Je n'ai rien retrouvé les concernant et, de
plus, n'étaient pas situés sur l'Yonne donc pas de péage
concernant le chômage des
moulins durant le passage des bateaux ou des trains de bois mais ce qui me
conforte dans ce que ces moulins ont bien existé est le fait que la Reine
donnait aux chanoines de Cudot un muid de froment de rente sur ses moulins
de Villeneuve.
Les derniers moulins trouvés en tant que reproduction
sont
ceux de Sens, dit le moulin du Roy
mais je ne pense pas qu'il avait cette allure au 15, 16, 17è
siècle et peut-être même avant.
Chose curieuse,
en suivant le livre de Max Quentin qui est ma source principale,
|
|
ajouté à cela la recherche des
documents qu'il signale lui-même comme ses sources et que j'ai
pu effectuer lors de mes visites aux AD d'Auxerre, je n'ai pas retrouvé de
moulin sur l'Yonne, sauf ce dernier
Malheureusement c'est
une erreur, qu'un ami a relevé de suite, étant des abords de Sens. Ce moulin
ne se situe pas sur l'Yonne il est sur la rivière de la Vanne à environ 200m
de l'Yonne. De nombreuses dérivations de la rivière "la Vanne" avaient été
aménagées pour alimenter les eaux des tanneries (le Moulin à Tan), les
coutelliers dans le quartier St Symphorien (wahou !!!!!!!je ne savais pas
que mon beau père avait été canonisé eh oui il s'appelait Symphorien) bon
soyons sérieux. Les minotiers installés sur ce réseau de la Vanne car ils
avaient besoin de la force motrice de ces rus, Mondereau, Monsalé, Boutours,
Gravereau etc. pour tourner.
et ceux de Pont sur Yonne
et Champigny sur Yonne. Mais de
redevances les concernant pour leur droit de péage aux pertuis "nada". Rien.
Les
pages suivantes seront consacrés aux ponts et leurs droits de péage, car là
aussi on payait, sur les marchandises transportées et les bateaux ainsi que
pour les trains de bois.
|
| |